MONGOLIE,
VERS LA FIN
DU NOMADISME ?

La Mongolie,
l’empire des steppes réputé pour ses paysages
infinis, ses chevaux vigoureux et ses tribus nomades demeure dans
l’esprit de chacun une terre de mystère où
la nature domine les hommes. Pourtant, derrière les images
médiatisées, se profile une réalité
plus mélancolique…
A
l’ouest, commence l’ère du «
nomad land», avec les réseaux dépassant les
frontières, tandis qu’à l’est, le nomadisme
s’endort, laissant derrière lui une image évanescente
de cavaliers parcourant les steppes avec leurs bêtes…
Les nomades mongols existent bel et bien mais désormais,
la majorité des mongols vivent dans les villes et leurs
environs. Une atmosphère nostalgique émane de cette
contrée magique, mais jusqu’à quand ces grandioses
espaces infinis resteront-ils tels quels ?
Un
environnement difficile à dominer 
Sans doute
doit-on aux conditions géographiques l’existence
du nomadisme. L’environnement mongol, entre toundra (végétation
basse, sans arbre) et désert, forêts et prairies,
steppes et montagnes apparaît particulièrement varié.
Le climat ultra-continental affiche des températures allant
de – 50°C l’hiver à 40°C l’été,
des précipitations faibles de 80 à 500 mm par an.
Les sols, même lorsqu’ils sont fertiles, restent fragiles
à cause des gels et du vent.
+
1,56 °C, c’est la hausse des températures depuis
les années 60. En Mongolie, les forêts tendent à
disparaître pour laisser la place à des steppes arides.
En
Mongolie, tout se prête au pastoralisme nomade. Les Mongols
y trouvent un équilibre durable entre les ressources et
la dynamique des besoins humains, entre l’énergie
dépensée et l’énergie restituée.
C’est la clé d’une présence viable et
prolongée.

Dans ce pays,
la mise en culture des terres est difficile. Les hivers rigoureux
et surtout le zud, période de très grand froid (-50°C
et tempêtes de neige pendant plusieurs jours)perturbent
le renouvellement des ressources. Il faut chaque année
replanter, tout recommencer : une production régulière
est presque impossible. Pourtant, la culture du blé a coexisté
pendant des milliers d'années avec l'élevage nomade
mais le système pastoral s’est toujours avéré
le plus adapté aux contraintes naturelles mongoles. En
effet, l’élevage permet aux nomades une optimisation
des déplacements, une « négociation »
entre quantité, qualité et effort fourni. Etre éleveur
est tout un art. Il s’agit de guider plus que d’amplifier
le troupeau, de transformer des ressources faibles en éléments
durables, de maintenir un équilibre. La dispersion, et
non la mobilité, est le moteur même de l’ensemble
du système pastoral nomade. Les nomades évoluent
dans un cadre le plus restreint possible, en passant d’un
pâturage à l’autre, contrairement à
une errance migratoire. Ils véhiculent une culture
symbolique, dans la façon de s’occuper des
chevaux, l’architecture unique des yourtes, les tissus
chamanes entourant les arbres… un ensemble de repères
pour un peuple en mouvement.
SUITE
|
Galsan
Tsichinag, un chamane en quête de pureté

Né en 1944 aux confins du désert de Gobi dans
une famille de nomades touvas (peuple qui vivait de la chasse
et de l’élevage en étroite communion
avec la nature avant d’être chassés de
leur terre par les Kazakhs dès 1959), Galsan Tschinag
se considère comme le représentant spirituel
de son peuple, les Touvas. Ayant fait ses études
à Leipzig où il est devenu professeur, il
se veut « un pont reliant l’Est et l’Ouest
». Ses récits romancent sa vie et offrent un
superbe témoignage de la vie nomade avant et après
l’impérialisme communiste. Ils mêlent
le roman d’apprentissage au plaidoyer écologique,
dont l’auteur s’avère un fervent défenseur,
le tout pétri de poésie chamane. On y découvre
la vie de ce petit garçon bercé par la chaleur
de la yourte et le respect des croyances traditionnelles.
La scolarisation obligatoire décrétée
par le gouvernement communiste sera vécue comme un
arrachement. Il témoigne dans ses ouvrages la difficulté
de l’exode, de la sédentarisation, de l’alcoolisme
dont les Mongols souffrent… Pour lutter contre ce
phénomène, Tschinag a lancé en 1995
l’opération Grande Nomadisation afin de ramener
les familles au pays.
A
lire :
« Ciel bleu »
« Le Monde gris »
« Sous le montagne blanche » aux Editions Métailié
www.editions-metailie.com
|
© EKWO
|
DOSSIER
ENVIRONNEMENT & PHENOMENES
Pour
Imprimer DD
Texte : Joséphine Le Gouvello
Photos : Agathe Derain et Damien Guerchois
SOMMAIRE
-
Un environnement difficile à dominer
- La yourte,
la maison mobile
- Vers un
nouveau système pastoral
- Les
villes mongoles en développement,
l'environnement
éprouvé
- Des
sols affaiblis par une agriculture
intensifiée
- Galsan
Tsichinag, un chamane en
quête de pureté
- Triste sort pour le daim musqué
- Sauvons
le lac Khovsgol !
- Historique
La
yourte, la maison mobile

 L’habitat
mongol lui-même traduit cette propension à se mouvoir.
Les yourtes (ger) sont conçues pour être montées
et démontées facilement, pour déplacer
les familles lorsque les conditions climatiques deviennent trop
rudes. De forme circulaire, elle est composée d’une
armature centrale en mélèze ou en pin entourée
par un treillis fait de branches de saules, de genévrier
et de frêne. Le tout est recouvert d’un tissu blanc
en feutre qui conserve la chaleur. A l’intérieur,
le mobilier est toujours le même. On retrouve systématiquement
des tapis contre le treillis et un poêle alimenté
par des bouses séchées (argal). Il est interdit
de l’enjamber ou d’y faire brûler des déchets
car ce feu est sacré. Les places au nord sont réservées
aux divinités bouddhistes et chamanistes. La personne
qui s’y installe est nécessairement la plus importante
de la famille. L’habitat
mongol lui-même traduit cette propension à se mouvoir.
Les yourtes (ger) sont conçues pour être montées
et démontées facilement, pour déplacer
les familles lorsque les conditions climatiques deviennent trop
rudes. De forme circulaire, elle est composée d’une
armature centrale en mélèze ou en pin entourée
par un treillis fait de branches de saules, de genévrier
et de frêne. Le tout est recouvert d’un tissu blanc
en feutre qui conserve la chaleur. A l’intérieur,
le mobilier est toujours le même. On retrouve systématiquement
des tapis contre le treillis et un poêle alimenté
par des bouses séchées (argal). Il est interdit
de l’enjamber ou d’y faire brûler des déchets
car ce feu est sacré. Les places au nord sont réservées
aux divinités bouddhistes et chamanistes. La personne
qui s’y installe est nécessairement la plus importante
de la famille.

Triste
sort pour le daim musqué
Le daim
musqué, aussi appelé chevrotain porte-musc,
appartient à une espèce primitive. Ce petit
quadrupède se nourrit de buissons et de lichen qu’il
attrape avec ses canines de 5 à 7 cm. Le daim musqué
sécrète du musc, une substance odoriférante
qui se développe en période de rut chez le
mâle et s’accumule dans une poche située
dans l’abdomen. Le musc est très convoité
pour ses qualités médicinales, il peut traiter
la douleur, les convulsions, les enflures et le délire
dans la médecine chinoise, et pour sa faculté
à garder les odeurs parfumées. Le musc ne
peut être recueilli qu’en tuant l’animal.
D’après TRAFFIC, le réseau mondial veillant
au commerce durable des espèces menacées,
le daim musqué est en train de disparaître
en Russie et en Mongolie à cause du braconnage. Le
musc se vend aux Etats-Unis trois à cinq fois plus
cher que l’or.
www.traffic.org
|
Vers
un nouveau système pastoral
Tout
au long des siècles, les Mongols se sont installés
et ont créé des villes rappelant l’architecture
chinoise. Des archéologues contemporains ont trouvé
la nécropole de Xiongnu à Gol Mod (245 av. J.C.),
avec ses tombes et ses forteresses. Cette découverte
prouve ainsi que la dialectique entre nomades et sédentaires
a toujours existé.
Il
n’est donc pas nouveau que les Mongols quittent les steppes
pour s’établir en ville. Aujourd’hui, la
majorité se concentre dans la capitale Ulan Bator et
dans ses environs, acceptant la sédentarisation malgré
des conditions de vie parfois très sommaires. Certaines
familles sont aussi contraintes de venir en ville quand les
hivers sont trop rudes et qu’elles ont perdu leur troupeau.

En
même temps, les formes de nomadisme ont changé.
La chute du communisme a engendré une privatisation des
terres. En 2002, une loi autorise la propriété
privée (cette mesure n’a été prise
que tardivement à cause de l’influence de la Chine)
et entraîne la prolifération de barrières.
Autour des yourtes de la banlieue l’Ulan Bator des clôtures
se construisent à une vitesse fulgurante…

 SUITE
SUITE
|
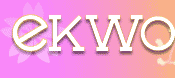
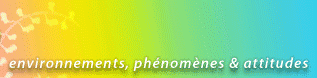



 L’habitat
mongol lui-même traduit cette propension à se mouvoir.
Les yourtes (ger) sont conçues pour être montées
et démontées facilement, pour déplacer
les familles lorsque les conditions climatiques deviennent trop
rudes. De forme circulaire, elle est composée d’une
armature centrale en mélèze ou en pin entourée
par un treillis fait de branches de saules, de genévrier
et de frêne. Le tout est recouvert d’un tissu blanc
en feutre qui conserve la chaleur. A l’intérieur,
le mobilier est toujours le même. On retrouve systématiquement
des tapis contre le treillis et un poêle alimenté
par des bouses séchées (argal). Il est interdit
de l’enjamber ou d’y faire brûler des déchets
car ce feu est sacré. Les places au nord sont réservées
aux divinités bouddhistes et chamanistes. La personne
qui s’y installe est nécessairement la plus importante
de la famille.
L’habitat
mongol lui-même traduit cette propension à se mouvoir.
Les yourtes (ger) sont conçues pour être montées
et démontées facilement, pour déplacer
les familles lorsque les conditions climatiques deviennent trop
rudes. De forme circulaire, elle est composée d’une
armature centrale en mélèze ou en pin entourée
par un treillis fait de branches de saules, de genévrier
et de frêne. Le tout est recouvert d’un tissu blanc
en feutre qui conserve la chaleur. A l’intérieur,
le mobilier est toujours le même. On retrouve systématiquement
des tapis contre le treillis et un poêle alimenté
par des bouses séchées (argal). Il est interdit
de l’enjamber ou d’y faire brûler des déchets
car ce feu est sacré. Les places au nord sont réservées
aux divinités bouddhistes et chamanistes. La personne
qui s’y installe est nécessairement la plus importante
de la famille.

