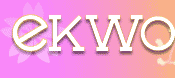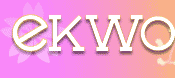 |
au
menu d' EKWO
|
|
|
| |
Les
repères indispensables
- Finansol
Cette association regroupe la vingtaine
d’institutions financières
solidaires qui comptent. Elle a aussi créé
un précieux label, délivré
par un comité indépendant,
aux produits financiers respectant des critères
de solidarité et transparence : ils
sont plus de quarante aujourd’hui.
www.finansol.org
- Novethic
Ce site créé par la Caisse
des dépôts est une bonne source
sur la responsabilité sociale des
entreprises. Il liste et évalue les
fonds ISR.
www.novethic.fr
- Le guide Alternatives économiques
Le magazine Alternatives économiques
publie régulièrement un guide
sur l’épargne alternative et
solidaire. La cinquième édition,
parue en septembre 2004, détaille
en 80 fiches, les placements éthiques
ou de partage, les produits bancaires, etc.
9 €
www.alternatives-economiques.fr
| Par
les Cigales
Clubs d’Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale de l’Epargne
Solidaire. Investissent dans des entreprises
« respectueuses de la place
de l’homme dans son environnement
».
www.cigales.asso.fr
La Nef
Société coopérative
qui accorde des prêts à
des projets à caractère
social, environnemental et culturel.
www.lanef.com
Fédération
Love Money pour l’emploi
Des associations qui accompagnent
la création, la reprise et
le sauvetage d’entreprises en
difficulté.
www.love-money.org
Garrigue
Cette société coopérative
finance des entreprises socialement
innovantes, respectueuses de l’humain
et de son environnement.
www.garrigue.net
Clefe
Les Clubs locaux d’Epargne pour
les Femmes qui Entreprennent soutiennent
la création ou la pérennisation
d’entreprises par des femmes.
www.racines-clefe.com
Habitat et Humanisme
Association qui loge et favorise l’insertion
de personnes en grande difficulté.
www.habitat-humanisme.org |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
DOSSIEREKWOATTITUDE
Texte : Emmanuelle Vibert
FINANCES
SOLIDAIRES,
Placez
votre argent selon vos valeurs |
« Finances » et «
solidaires »… Quelle idée saugrenue
de coller ces deux mots ensemble. Pourtant c’est
une alchimie possible. Réconcilier placements
financiers avec certaines valeurs de partage, voilà
le pari que font de plus en plus d’associations,
mais aussi de banques. Le secteur balbutie, mais
son succès est grandissant. Alors envie de
placer votre modeste pécule en lui donnant
du sens ? Suivez ces quelques repères. |
|
Les
placements éthiques
Une nébuleuse un peu fourre-tout

Les placements éthiques n’appartiennent
pas à la famille des finances solidaires
stricto sensu. Mais comme ce proche cousin
fait beaucoup parler de lui, il est bien
de savoir à qui l’on a affaire.
Pendant des lustres, pour investir en Bourse,
on ne s’est préoccupé
que de la bonne santé financière
des entreprises. Or depuis la fin des années
90 et sous la pression des consommateurs,
certains gestionnaires prennent en compte
des critères environnementaux, sociaux.
D’autres excluent de leurs fonds des
entreprises ne respectant pas certaines
valeurs morales. Sont hors jeu l’armement,
le jeu, le tabac… On appelle ça
les « critères d’exclusion
».
Les placements éthiques, c’est
l’ISR pour les intimes : l’investissement
socialement responsable. Et il prolifère,
avec plus d’une centaine de fonds
aujourd’hui sur le marché français.
La plupart des grandes banques et des gestionnaires
ont créé le leur. Toute proportion
gardée - l’ISR ne représente
pas plus de 1 % des fonds existants - les
placements éthiques sont à
la mode et c’est tant mieux. Ils forcent
les entreprises à plus de transparence.
Mais qui décide qu’une société
est éthique ou ne l’est pas
? Pour cela, on s’appuie sur des agences
de notation sociale et environnementale.
Elles sont une douzaine en France, la plus
connue d’entre elles étant
Vigeo. Ce printemps, Novethic publie en
partenariat avec Morningstar et Vigeo, le
RATING PLANETS®. Son échelle
de 1 à 5 PLANETS® (la meilleure
note) mesure la responsabilité sociale
de 480 fonds distribués en France
gérés par 116 sociétés
de gestion. Mais ces agences tâtonnent
encore à la recherche de méthodes
de notation vraiment efficaces et indépendantes.
Et leurs critères ne sont pas toujours
très exigeants. Ainsi, seuls 75 %
des fonds éthiques intègrent
les normes du développement durable.
Et pas plus de 15 % sont regardants sur
les « critères d’exclusion
». Autant dire qu’on est encore
très loin d’un label placement
éthique fiable…
Liste de fonds :
On en trouve la totalité sur www.novethic.fr
et une sélection dans le guide sur
les Placements éthiques d’Alternatives
économiques
Contraintes
et avantagess
:
Ils ne sont pas forcément moins rentables
que des fonds classiques. Les critères
sociétaux peuvent en effet désigner
des entreprises plus performantes sur le
moyen terme.
Une part dans un fonds éthique peut
varier de quelques euros à environ
150.
|
Les
investissements de partage et solidaires

Mes intérêts sont
les leurs |
|
L’idée
des fonds de partage est simple, mais il
fallait l’inventer (voir l’encadré
sur Karol Sachs). On place son argent dans
un fonds commun de placement (FCP). Cet
argent est investi en Bourse dans diverses
actions et/ou obligations. Ce FCP dégage
des intérêts que l’on
partage avec une institution qui agit dans
l’humanitaire, le développement
ou encore l’environnement. Par exemple,
avec le FCP « Epargne solidaire »
du Crédit Coopératif, vous
avez le choix entre 14 ONG, de la Fondation
de France, à Handicap International,
en passant par Médecins du Monde.
Dans d’autres cas, un organisme solidaire
et une banque s’associent pour proposer
un produit financier, comme la Sidi et le
Crédit Coopératif qui ont
lancé en 1983 le FCP « Faim
et développement » (voir l’encadré
sur Karol Sachs).
Les investissements solidaires sont une
variante (notez que certains fonds sont
mixtes : à la fois de partage et
solidaires). Une partie de l’argent
placé dans un FCP va directement
au financement de projets solidaires, à
des sociétés non cotées
en Bourse. C’est le cas avec le FCP
« Insertion Emploi », distribué
par la Caisse d’épargne : entre
5 et 10 % des fonds sont confiés
à France Active, qui investit notamment
dans des entreprises d’insertion.
Où vont les 90 % des fonds restant
? En principe, ils sont consacrés
à des sociétés dites
« éthiques » par les
agences de notation sociale. On se retrouve
donc face au même problème
que pour l’ISR. C’est de l’éthique,
soit, mais selon quels critères ?
Le journal Politis (Hors Série novembre
décembre 2004) soulève par
exemple que le FCP « Insertion Emploi
» est sensé « investir
en priorité dans les titres de sociétés
qui favorisent l’emploi et l’insertion
sociale ». Or, au premier rang des
placements de ce fonds on trouve Total,
Sanofi-Aventis ou France Télécom,
des entreprises pas particulièrement
immaculées concernant la sauvegarde
de l’emploi.
Bref, les investissements de partage et
solidaires participent d’une façon
de plus en plus indispensable au financement
d’actions liées à l’humanitaire,
au développement, à l’environnement…
Ce qui ne les met pas forcément à
l’abri de quelques contradictions.
Les
fonds et leurs banques ou gestionnaires
Nota bene : à peu de choses près,
les Sicav (Sociétés d’investissement
à capital variable) fonctionnent
comme les FCP.
- Labellisés Finansol
:
FCP Choix solidaire, Crédit coopératif
FCP Epargne solidaire, Crédit Coopératif
FCP Epargne solidarité habitat, Crédit
Lyonnais, Crédit Coopératif
Sicav Eurco solidarité, Crédit
Lyonnais
FCP Faim et développement, Crédit
Coopératif
FCP Faim et développement compartiment
équilibre, Crédit Coopératif
FCP Faim et développement compartiment
horizon, Crédit Coopératif
FCP Faim et développement compartiment
trésorerie, Crédit Coopératif
FCP Insertion emploi, Caisses d’Epargne,
IXIS AM
FCP Macif croissance durable et solidaire,
Macif Gestion
FCP Pacte solidarité logement, Crédit
Agricole
FCP Pacte vert tiers-monde, Crédit
Agricole
- Non labellisés Finansol
FCP Action Sud, Crédit Lyonnais
FCP Avenir partage, Banque fédérale
mutualiste
FCP CM France emploi, Crédit mutuel
Sicav Conciliance, Société
Générale
FCP Ethique et partage, Financière
Meeschaert
OPCVM Humanis investissement, société
de gestion GPK Finance
FCP Investissement et partage, Financière
Meeschaert
Sicav Libertés et Solidarité,
La Poste
FCP Terre nouvelle, Crédit industriel
de l’Ouest (Banque du groupe CIC)
Contraintes
et avantages
:
Les produits de partage bénéficient
d’une fiscalité avantageuse
: une réduction d’impôt
de 66 % du montant des dons (elle n’était
que de 60 % pour les déclarations
de 2003), qui s’élève
à 75 % pour les associations offrant
aide alimentaire, soins et hébergement
aux démunis. Autant dire que l’état
participe lourdement à votre effort
de générosité.
La durée recommandée pour
le placement varie entre 2 et 5 ans.
On peut le plus souvent souscrire une seule
part, dont le montant s’échelonne
d’une quinzaine d’euros à
plus de 450. |
Plus
de 3 milliards d’euros : c’est le total
des fonds ISR français.
Les
autres produits bancaires

Solidarité déclinée |
 |
Les banquiers saupoudrent désormais
un peu de solidarité sur plusieurs
produits. Faites votre choix. Une carte bleue
internationale Visa, grâce à
laquelle à chaque opération
de retrait une association humanitaire reçoit
un don de 0,06 euros ? Et sans incidence sur
votre compte car c’est la banque qui
le verse ? C’est la carte Agir du Crédit
Coopératif. En 2003, 19 000 euros ont
été distribués à
Médecins du Monde, Energies pour le
monde, Aides, Action contre la faim ou à
l’Unapei.
Vous avez besoin d’un compte épargne
? Prenez par exemple le Compte épargne
nature de la Nouvelle économie fraternelle
(Nef). On place son argent (au moins 500 euros)
pour 25 mois minimum. Le rendement varie selon
la durée du placement : entre 2,1 %
et 4 % sur dix ans. On peut choisir de donner
ses intérêts (la totalité
ou une partie seulement) à la Nef.
Dans ce cas, cette dernière utilise
l’argent pour accorder des prêts
à des projets liés à
l’environnement ou au développement
durable. Ou alors on destine ces mêmes
intérêts à cinq partenaires
de la Nef : le réseau Biocoop, le Centre
national d’information indépendante
sur les déchets (Cniid), Nature et
progrès, WWF France et Sortir du nucléaire.
Encore
un exemple de ces nouveaux produits financiers
solidaires, avec l’assurance-vie Habitat
et Humanisme. C’est une assurance-vie
classique. La majorité de vos fonds
sont placés dans des actions ou des
obligations. A ceci près : au minimum
10 % de ces l’investissement vont
à l’achat d’actions de
la Foncière d’Habitat et Humanisme
et chaque année, une partie des frais
de gestion est reversée à
l’association. Cet argent lui permet
de poursuivre son action d’insertion
par le logement. Mais toute la performance
de l’assurance-vie reste à
l’épargnant (+4 % en 2003)
Il existe d’autres exemples, comme
le livret Agir du Crédit Coopératif
qui a versé 302 000 € de dons
en 2004. Pour l’épargne, l’assurance-vie
ou pour ouvrir un compte courant, une quinzaine
de produits permettent aujourd’hui
de faire vivre son argent en solidaire au
quotidien. Et la plupart du temps, c’est
quasiment indolore pour le volume de votre
porte-monnaie.
Les produits bancaires et leurs banques
ou sociétés d’assurance-vie
- Labellisés Finansol
Codesol (Codevi), Crédit coopératif
Codevair (livret d’épargne),
Banque populaire d’Alsace
Compte courant Cofides, Cofides Nord-Sud
Compte de dépôt à terme
de La Nef
Compte épargne insertion, La Nef
Compte épargne nature de la Nef
Livret Agir, Crédit coopératif
Livret Caisse solidaire Nord-Pas-de-Calais,
Crédit coopératif
Livret Nef-Crédit coopératif
Munisolidarité placement (Bons de
caisse), Crédit municipal de Nantes
Assurance-vie Habitat et humanisme, Assurance-vie
prévoyance (Avip)
- Non labellisés Finansol
Carte Agir (carte bleue internationale Visa),
Crédit coopératif
Compte chèque La Nef-Crédit
coopératif
Actiplus, option Agir (assurance vie), Crédit
coopératif
Skandia Ekité (assurance vie), Skandia
France
Contraintes
et avantages
Si le produit implique un don à une
association, les impôts vous font
ici aussi cadeau d’une réduction
de 66 % du montant des dons.
Pour ouvrir un livret, un Codevi ou un compte
épargne solidaire, il peut parfois
suffire de 30 euros.
|
Les
investissements directs

Pour s’engager encore plus |
|
Beaucoup des institutions de la finance
solidaire proposent de participer directement
à leur capital. Dans ce cas, les
intermédiaires bancaires disparaissent.
Du coup, c’est une histoire entre
vous, investisseurs, et par exemple la Nef
(citée plus haut) qui investit notamment
dans des projets d’énergies
renouvelables ou d’aide à la
réinsertion. Pour 30 euros (soit
une part), vous pouvez en devenir actionnaire.
Et ce sera 152 € pour entrer au capital
de la Société d’Investissement
et de développement international
(Sidi) qui alimente des organismes de microcrédit
dans les pays du sud.
Vous choisissez de participer au capital
des Cigales ? Il faudra aussi y consacrer
de votre temps. Ces Clubs d’Investisseurs
pour une Gestion Alternative et Locale de
l’Epargne Solidaire, investissent
dans des entreprises « respectueuses
de la place de l’homme dans son environnement
». Le principe est le suivant : 5
à 20 personnes cotisent dans une
caisse commune. Le montant est au choix.
L’argent est investi dans des prises
de participation (toujours minoritaires)
de sociétés. Plusieurs fois
par an, on se réunit pour recevoir
les créateurs, décider des
placements… Et au bout de 5 ans (renouvelables
une fois), le club liquide son porte-feuille
et le répartit en fonction des parts
de chacun.
Avec ces investissements directs dans l’économie
solidaire, ne vous attendez pas à
gagner le jack-pot. Il s’agit ici
de bien autre chose : donner de sa personne.
Dans un club d’investisseurs comme
les Cigales, on appréciera votre
expérience et votre accompagnement
tout autant que votre argent.
Et c’est finalement le plus sûr
moyen de contrôler au maximum la destination
de ses économies. Dommage que seule
une minorité en ait le temps et les
moyens.
Liste
des sociétés de capital-risque
dans lesquelles on peut acheter des parts
Labellisées par Finansol
:
- Autonomie et Solidarité
- Garrigue
- La Caisse Solidaire du Nord Pas de Calais
- Femu Quì
- La Nef
- La Sidi
- La SIFA
- La Société Foncière
Habitat et Humanisme
- Habitat et Humanisme Développement
- Habitats Solidaires
- Initiatives pour une Economie Solidaire
(IES)
- Oikocredit
- Les Cigales
- Les Clefe
Non labellisées par Finansol
- Bretagne Capital Solidaire
- Fédération Love Money
- Herrikoa
Contraintes
et avantages
Une réduction d’impôt
est accordée à hauteur de
25 % de l’investissement réalisé.
Récupérer son argent peut
prendre du temps : dans certains cas, on
peut attendre jusqu’à 5 ans
après une demande de remboursement.
C’est de toute façon un engagement
sur plusieurs années.
Une part s’élève à
une douzaine d’euros ou plusieurs
dizaines.
Chiffre à faire ressortir
Les 3/4 des finances solidaires sont mobilisées
pour l’insertion par le travail et
par le logement en France
Source : Baromètre Finansol-la Croix-Crédoc |
13
% des 31 150 entreprises nouvelles créées
en France en 2002 par des chômeurs longue
durée l’ont été avec
le soutien des financements solidaires.
Grâce
aux finances solidaires, en 2004 :

- 600 000 microcrédits accordés
dans 45 pays du Sud
Et en France :
- 8500 projets de création ou de développement
d’entreprises financés
- 13 000 emplois créés
- 2350 nouvelles familles, en situation de
grande précarité, logées
Source : Baromètre Finansol-La Croix-Crédoc-Ipsos
édition 2004 |
Des
centaines de mutuelles de solidarité
créées grâce à
la Sidi
 |
|
La Sidi, lancée en 1983 par le Comité
Catholique contre la Faim et pour le Développement
(CCFD) soutient à travers le monde
entier des structures financières de
microcrédit. L’idée des
Muso est née au Sénégal
en 1995, lors d’un atelier réunissant
des membres de la Sidi et des organisations
paysannes. Ces dernières critiquent
l’offre de microcrédit qui leur
est faite : trop rigide. Voilà qu’elles
inventent une forme nouvelle qui va leur permettre
de capitaliser et d’emprunter : les
mutuelles de solidarités qui prennent
le nom de Muso.
Le principe est simple : un petit groupe cotise
régulièrement dans une caisse,
la caisse verte. Il accumule du capital et
octroie des prêts à ses membres.
Les conditions sont fixées collégialement.
Pour remplacer par exemple le système
du taux d’intérêt pas assez
souple et trop compliqué, les taux
sont fixés au coup par coup, de façon
empirique. Dans une autre caisse, rouge, on
cotise en prévision des coups durs
: la maladie d’un enfant, la rénovation
d’un puits… Et pour éviter
les vols, un des membres du groupe surveille
la caisse, fermée par un cadenas, un
autre est gardien de la clé.
La Sidi a essaimé cette pratique des
Muso dans de nombreux pays : Haïti, Madagascar,
Kivu, Burkina Faso, Mali ou Tchétchénie.
Au Kivu par exemple, il en existe 200 qui
regroupent 5000 personnes autour d’un
capital de 50 000 dollars.
Pour investir dans la Sidi, on peut acheter
des actions dans son capital ou des parts
du FCP Faim et Développement du CCFD.
www.sidi.fr |
2005
année internationale du micro crédit

Depuis son invention, en 1976, au Bangladesh,
par le banquier Muhammad Yunus (qui a plus
tard créé la Grameen Bank),
le microcrédit a fait ses preuves tout
autour du monde. Il s’agit de prêter
de très petites sommes à des
exclus du système bancaire afin qu’ils
créent leur activité et sortent
de la misère. Aujourd’hui, il
y a près de 60 millions d’emprunteurs.
Beaucoup sont des femmes : sur 3,7 millions
de clients, la Grameen Bank en compte 96 %.
Elles confirment ainsi leur rôle clé
dans le développement. |
Portraits
de femmes : 
-
Lize Nhaca, veuve de 5 enfants au Mozambique,
a voulu créer une petite entreprise
de pêche. Après deux crédits
de 260 et 690 US$, elle est aujourd’hui
capable d’entretenir les 16 membres
de sa famille. Elle a aussi construit une
maison et emploie quatre personnes.
-
La cambodgienne Phorn Hun ne possédait
rien et vivait dans une simple cabane au
toit de paille. Avec un emprunt de 25 US
$, Phorn s’est lancée dans
un petit commerce de nouilles. Quelques
années après, elle a pu acheter
un morceau de terrain, et y construire une
maison en bois avec un luxueux toit en taule.
-
Fortunata Maria de Aliaga vend des fleurs
dans les rues de La Paz, en Bolivie depuis
toujours. Elle s’est unie à
trois autres femmes pour demander un prêt
et être capable d’acheter ses
fleurs en gros, à un prix bien meilleur.
C’est comme ça qu’elle
a pu financer la scolarité de ses
trois enfants.
Pour
encourager ce système de finances
solidaires qui lutte efficacement contre
la pauvreté, les Nations Unies ont
déclaré 2005, année
internationale du micro crédit.
www.yearofmicrocredit.org |
Karol
Sachs 
L’inventeur des
fonds de partage
Nous sommes en 1983 et c’est une révolution.
Le Crédit Coopératif et Solidarité
Internationale pour le Développement
et l’Investissement (Sidi) lancent un
mécanisme financier inédit,
parce que solidaire : le Fonds Commun de Placement
(FCP) « Faim et Développement
». C’est le début des finances
solidaires d’aujourd’hui.
L’initiateur de cette révolution
au Crédit Coopératif, c’est
Karol Sachs. Chargé de mission, il
est par ailleurs d’origine polonaise
et cofondateur de l’association de soutien
à Solidarnosc. Il croise alors le chemin
de Paul Durand, du Comité catholique
contre la faim et pour le développement
(CCFD), qui accompagne aussi les opposants
au régime polonais. Ce dernier lui
pose une colle : pour améliorer leur
trop maigre retraite, les congrégations
religieuses épargnent, comment investir
cet argent pour le développement des
pays du sud sans prendre de risque financier
?
Réponse de Karol Sachs : il faut dissocier
les choses. Et si les épargnants souscrivaient
à des obligations françaises,
donc solides, mais se contentaient de l’inflation
? La différence entre le placement
en Bourse et l’inflation serait offerte
au CCFD.
La direction du Crédit Coopératif
suit. Et peu importe si c’est du jamais
vu qu’une banque, univers on ne peut
plus laïque, se lie à une association
catho. « Le Crédit Coopératif,
raconte Karol Sachs aujourd’hui chargé
de mission financements solidaires et alternatifs,
a cru ce qu’aucune banque ne pouvait
alors croire : les épargnants ont d’autres
préoccupations que le rendement. »
Cet argent, le CCFD le consacrera finalement
non pas aux congrégations religieuses
mais à la Sidi, créée
pour l’occasion. Cette société
anonyme devient le volet économique
de l’action du CCFD, en soutenant des
institutions financières de microcrédit
dans le monde. Ca aussi, c’est du jamais
vu : une association catholique qui met son
nez dans l’économie.
Et pourtant le succès du FCP est immédiat
et durable : 5000 souscripteurs aujourd’hui
et 22 millions d’euros de dons produits
entre 1983 et 2004. Depuis, beaucoup l’ont
d’ailleurs copié et le FCP «
Faim et Développement » a de
nombreux petits frères, y compris au
sein du Crédit Coopératif, qui
reste à l’avant-garde avec dix
produits labellisés par Finansol. |
|
|
|
|
|
|